« Je dors dans un quartier raflé en Quarante-deux,
les voix dans les cours intérieures n’ont cessé
de retentir d’appels aux dieux ou à rien
du tout, rien que néant tragique, laïc,
aucun sens, nul trajet renouvelé dans la cage
d’escalier, c’est par les toits que la rumeur enfla »
Le passé le tire fréquemment par la manche, notamment lors de ses promenades dans le nord-est parisien, en lui conseillant de délaisser, un temps, gouttières, chats, boutiques et vitrines pour s’accorder un pas de côté afin d’aller dire bonjour à ceux qui passent d’interminables jours de repos dans les cimetières.
« Un jour de ventôse et de grêle on alla
au cimetière Picpus saluer les charniers
endormis sous l’herbe où rêvaient sans têtes
les Auguste, les Charlotte, les Adrien domestiques,
aubergistes, dentellières, ex-nobles, crieurs guillotinés
amenés dans de fructueuses charrettes tout droit du Trône
renversé pour séjourner en vrac au fond d’une fosse »
Les rues qu’il arpente, et qui gardent en elles les silhouettes de Léon-Paul Fargue et d’Yves Martin, et où s’imprime peut-être toujours, passagèrement, celle de Jacques Réda, ces rues qu’il sillonne par tous les temps, il lui arrive de les abandonner temporairement pour s’octroyer de plus lointaines pérégrinations. On peut alors le retrouver en randonnée dans les alpages ou à l’ombre dans l’hémisphère Sud, ou près d’une fontaine en Espagne, ou installé à bord d’un avion qui relève son nez juste avant l’atterrissage. Où qu’il se trouve, sa vigilance reste de mise et sa sensibilité en émoi. Partout les mots s’assemblent pour prendre la mesure de l’endroit et pour le rendre visuellement vivant en s’attachant à ceux qui y séjournent.
« Avec un sac à dos de pénitent,
un philosophe allemand dans la poche,
ils partaient tôt le matin en silence
gravir les monts, tutoyer les edelweiss,
pour redescendre au soir éblouis, pleins
de condescendance à l’endroit des plaines,
parfois s’arrêtant pour se rafraîchir
dans la pénombre d’un lieu de culte »
On le voit qui avance à son rythme. Il n’aime pas les accélérations brutales. Préfère rester calme, posé, attentif. De l’oiseau, auquel il adresse un clin d’œil dès le titre, il apprécie le vol, la légèreté, le chant. Migrateurs ou sédentaires, ou présents dans l’un de ces musées qu’il aime visiter, beaucoup d’entre eux apparaissent dans ces pages.
« Dès que les jours décroissent les oies bernaches
sorties d’un tableau de Johannes Larsen
quittent le sol vers leurs quartiers d’hiver, plein sud,
est-ce que c’est gris, est-ce qu’il fait nuit, sous huitaine
leur cœur aura délaissé l’hémisphère blanc,
survolant les lacs vite, c’est du sang, le temps
s’écoule, durcit à l’air libre, aucune issue
hors l’envol pour contrer le froid, imiter la fuite
par mille coups d’ailes »
Chez Étienne Faure, le titre du poème, souvent écrit d’un seul tenant, en une respiration souple, jamais haletante, n’apparaît, en italiques, qu’à la fin de celui-ci. Ses invitations à flâner (il y en a ici plus de cent) font mouche. Impossible de le laisser partir à l’aventure, le nez au vent et la pensée en alerte, sans l’accompagner.
Étienne Faure : Vol en V, éditions Gallimard.




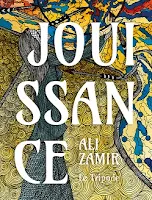













.jpg)

