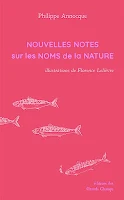« Au bout de cinq mois pas sûr qu’il ait ouvert la bouche pour parler d’autre chose que de ciment, de briques et de fers à béton. Quand il ne faisait pas ses comptes sur un calepin il regardait par terre plongé dans ses pensées. À Povla son village il ne mettait jamais les pieds. »
Le décor est austère. Une route précaire, ouverte au bulldozer, permet d’accéder au chantier. Ils y sont depuis cinq mois mais ce jour-là, la pluie, qui tombe sans discontinuer, les oblige à faire relâche. Et à parler, à dialoguer, à s’exprimer enfin, à raconter ce que tous (à commencer par les plus anciens) ont dû subir (prison, travaux forcés, immigration, etc) du fait de leur appartenance à la minorité hellénophone d’Albanie, sous le régime du dictateur Hodja.
« En 75 ils m’envoient à Spaç dans les mines de pyrite et de cuivre qu’y a pas plus profond, jusqu’en 85 à la mort de Hodja. Là-bas j’étais wagonnier. Je devais faire mes sept wagons par jour. Je rentrais sous terre le matin et je ressortais la nuit. Là-bas je l’ai vue dans les yeux la malemort. Je trimais dans la zone mortelle, ça faisait que de s’ébouler. »
L’un après l’autre, ils se racontent, utilisent le seul dialecte qu’ils connaissent, celui, imagé, direct et inventif, que les générations précédentes leur ont transmis et que Dimitriou maîtrise à la perfection. La traductrice n’est pas en reste, qui parvient à lui rendre sa tonalité et sa spécificité. Cette langue se prête à l’oralité. Les ouvriers l’affectionnent. Rocailleuse, subtile, populaire, émaillée de dictons, elle constitue leur bien commun et donne une résonance particulière à leurs propos.
Tous ont derrière eux une vie pas facile. De lourds fardeaux qu’ils portent comme ils peuvent, s’en allégeant ponctuellement en les partageant avec les autres. Parfois, la parole laisse place aux chants. Les non-dits se colorent alors d’un peu de douceur. Ils entonnent quelques strophes, s’accordent des pauses, sortent les verres et l’alcool, accueillent des gens de passage, des bergers, des musiciens gitans qui reviennent d’une noce. Les langues se délient de plus en plus. Des choses trop longtemps tues sortent enfin. L’émigré taciturne va, lui aussi, s’ouvrir comme il ne l’avait jamais fait auparavant. Il se dit coupable de la mort d’un homme.
Au fil des heures, au bout du compte (des contes), les récits s’assemblent, se recoupent et donnent corps à un roman polyphonique extrêmement vivant, dynamique, chargé de terribles souvenirs mais également ponctué d’anecdotes plus légères et de traits d’humour bien sentis. Ce sont les humbles, les invisibles, les travailleurs manuels, les laissés pour compte, ceux qui n’ont (ordinairement) pas droit au chapitre qui s’expriment dans la montagne. Ils détachent des pans de leur rude histoire en la frottant à l’autre, la grande, la faucheuse, l’avaleuse des langues et des cultures minoritaires qui n’aura pas réussi à les faire taire.
Sotiris Dimitriou : Dieu leur dit, traduit du grec par Marie-Cécile Fauvin, Quidam éditeur.