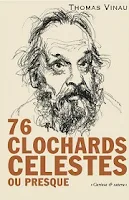« Le machin a dégringolé du ciel, ou plutôt des feuillages au-dessus de moi, pour s’écraser devant mes pattes, fruit pourri et ridicule dans lequel j’ai trébuché en couinant comme un petit chien. Le temps de reprendre mes esprits et les pieds toujours emberlificotés dans ses jambes, je me suis fait insulter allègrement par ce qui ressemblait à un mélange entre Marcello Mastroianni et le capitaine Haddock. »
Cette rencontre fortuite va l’inciter à prendre en filature cet homme qu’il voit régulièrement attablé, sirotant des verres de rosé tout en griffonnant dans un carnet, tôt le matin, à l’heure du petit-déjeuner, sur une terrasse du centre-ville. Il l’appelle Marcello, lui trouvant un air de ressemblance avec l’acteur aux yeux souvent nimbés de solitude. Le personnage l’intrigue et l’amène même à penser, intuition bizarre, qu’il est peut-être la représentation vivante de ce qu’il pourrait devenir, lui l’adepte du shit, des mélanges corsés et des nuits blanches, quand il arrivera, bon an, mal an, au bout de son rouleau.
« Et si ce type devant, ce pirate clodo, ce Mastroianni usé, si ce type-là, Marcello, c’était moi ? Je veux dire, moi plus tard. Une version de moi, en vieux. Une version qui aurait totalement foiré. »
Le mieux, pour y voir plus clair, est de savoir de quel bois se chauffe cet inconnu qui l’attire, savoir où il loge, ce qu’il fabrique de ses journées, quel est son itinéraire quotidien, quels sont ses secrets. Pour répondre à ces questions, le narrateur se mue en détective privé. Il n’est pas au bout de ses surprises et il va y laisser quelques plumes. On ne s’approche pas impunément d’un tel personnage.
C’est cette enquête, menée avec malice et désinvolture, à coups de chapitres courts, en usant d’un débit rapide et entraînant, que retrace Thomas Vinau. La filature se fait sur la pointe des pieds, entre les arbres et les herbes folles, pour aboutir à un îlot abandonné, niché au cœur de la ville, où vivent d’étranges animaux de compagnie. Elle prend, au gré de ses sinuosités, des allures de parcours initiatique. Un voyage ébouriffant. Qui permet à celui qui se sentait à l’étroit dans sa vie de perdant mélancolique de s’imaginer en partance vers un monde qu’il ne connaît pas encore mais qui aiguise déjà sa curiosité
« Le monde c’est plein de monde. Je veux dire qu’il existe une multitude de mondes différents dans ce monde. Plein de mondes en même temps. Il y a un monde à apprendre, un autre à découvrir, un autre à inventer. »
Thomas Vinau : Marcello & Co, Gallimard, collection Sygne.