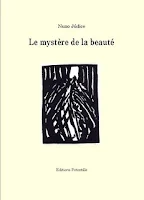Il suffit d’ouvrir l’un de ses livres au hasard, ce peut être L’été, l’éternité (Chambelland, 1970), ou Oh, dites-moi si l’Ici-bas sombrera ? (Arfuyen, 2002) ou tout simplement celui-ci, Bonheurs d’Olivier Larizza,
pour entrer de plein pied dans l’œuvre poétique de Jean-Paul Klée. Ce
qu’on y découvre étonne et envoûte. La langue est vive, dételée, non
soumise aux règles en vigueur dans l’ordinaire beau et bon parler. Le
lyrisme a peu à voir avec ce qu’on en connait de réminiscences purement
francophones. Un tempo libre s’y est subtilement invité et les poèmes,
dans lesquels l’auteur glisse césures, ponctuations et désirs
orthographiques et typographiques particuliers, débordent de vitalité.
Au fil des pages, son quotidien et sa biographie s’y révèlent. Par
petites touches, avec émotion, reliant les fils d’un itinéraire à jamais
marqué par l’assassinat, en avril 1944, de son père Raymond-Lucien
(philosophe, compagnon de Sartre) au camp de concentration du Struthof.
« mon père a été massacré affligé on ne
saura pas comment il a disparü & les
fümées n’en reviennent jamais elles qui
ont passé dans l’horrible cheminée qu’on
aperçoit encor à la sortie Krématoria,
l’air n’en pouvait plus & le Ciel
étoufferait de sanglots il s’est déchiré
en deux »
saura pas comment il a disparü & les
fümées n’en reviennent jamais elles qui
ont passé dans l’horrible cheminée qu’on
aperçoit encor à la sortie Krématoria,
l’air n’en pouvait plus & le Ciel
étoufferait de sanglots il s’est déchiré
en deux »
L’amitié que Jean-Paul Klée porte à Olivier Larizza (écrivain lui
aussi, né en 1975) a débuté en octobre 2000. Depuis, il ne s’est pas
passé un jour sans qu’il pense, écrive et trouve grande énergie grâce à
celui qu’il a « remarqué choisi préféré / à toute chose d’avant lui ! ».
Plus de 7000 pages se sont ainsi accumulées, la plupart inédites mais
quelques unes fort heureusement déjà disponibles.
Après C’est ici le pays de Larizza (édition BF, 2003) et Trésor d’Olivier Larizza
(éditions des Vanneaux, 2008), voici ces « bonheurs » activés grâce à
l’ami (qu’il nomme ainsi ou « bel enfant » ou « mon ange » ou
« le petit loup bleu ») et à qui ils retournent après s’être nourris de
la douceur, de la spontanéité, des longues promenades dans Strasbourg,
de l’angoisse toujours en embuscade et des aléas journaliers qui
rythment sa vie. Le présent lui est plus salutaire que le passé. Sur
lequel il ne revient que pour pointer ses failles, ses désillusions, son
manque à vivre comblé par la poésie et son sens peu aigu des tâches
matérielles non assurées parce que jugées moins nécessaires que
l’écriture.
« j’ai perdü argent et relations à ne pas
répondre des courriers importants car j’avais
jamais le temps Toute la journée me filait à
courir la gredine poësie je la voyais
jours & nuits dans les kafés où j’abattis à la
main des feuillets par milliers !...
ça m’a pris forcément des années où hormis
d’écrire ma rêverie je n’ai foutü
rien !... les formülaires de santé le dossier
pour moi retraité la banque qui lentement
pourrissait »
répondre des courriers importants car j’avais
jamais le temps Toute la journée me filait à
courir la gredine poësie je la voyais
jours & nuits dans les kafés où j’abattis à la
main des feuillets par milliers !...
ça m’a pris forcément des années où hormis
d’écrire ma rêverie je n’ai foutü
rien !... les formülaires de santé le dossier
pour moi retraité la banque qui lentement
pourrissait »
Page à page, Jean-Paul Klée édifie un monument poétique à « l’oiseau
miraculeux qui / très doucement devenir me fit / ce que je
suis », dit-il en ouverture du livre. Notant ce dont il lui est
redevable de joie retrouvée, il ne dérive cependant pas vers l’exercice
d’admiration. Ce qu’il doit à Olivier Larizza, c’est une impulsion, une
source, une inspiration, un étonnement qu’il ne pensait plus connaître,
une envie irrépressible de poursuivre la route (humaine et poétique). Sa
douceur et sa bonté (que certains, pris dans les tenailles et la
dureté du monde, pourraient prendre pour de la naïveté) et ce don de soi
pour l’autre – et les autres – sont rares et remarquables.
Jean-Paul Klée
est une sorte de phénomène littéraire. Il maîtrise toutes les
subtilités du langage. Il sait le triturer, le casser, le recomposer. Et
être drôle, tragique, baroque, pudique, impudique. Il ose s’aventurer
là où tant d’autres s’autocensureraient. Ses cartons sont pleins
d’inédits. Des milliers de feuilles 21 X 29,7 manuscrites où se trouvent
poèmes, pages de journal et textes en prose. Pour l’instant, une
douzaine de livres ont vu le jour (certains chez des éditeurs qui ont
depuis fermé boutique). Bonheurs d’Olivier Larizza, le premier des « cahiers Jean-Paul Klée » que les éditions des Vanneaux ont décidé de lancer, se termine par un hommage à sa mère, décédée le 29 avril 2010.
« ombré
d’une beauté sans nom le
visage de ma mère va
vers le rien (le désordre) l’inau
dible dessiné par la terre & le
silencieux cercueil où s’abrite encor
ce qui d’elle a demeuré ici-bas »
Jean-Paul Klée : Bonheurs d’Olivier Larizza, postface de Jean-Pascal Dubost, éditions des Vanneaux.
d’une beauté sans nom le
visage de ma mère va
vers le rien (le désordre) l’inau
dible dessiné par la terre & le
silencieux cercueil où s’abrite encor
ce qui d’elle a demeuré ici-bas »
Jean-Paul Klée : Bonheurs d’Olivier Larizza, postface de Jean-Pascal Dubost, éditions des Vanneaux.