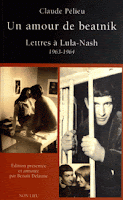Dans 69 vies de mon père,
Ludovic Degroote, donnant la parole à celui à qui il dédiait son
récit, évoquait déjà la disparition de sa sœur Godeleine et l’entrée
soudaine et inadmissible de la mort au domicile familial. Cette fois,
c’est son livre à elle qu’il conçoit en le faisant débuter par un
monologue implacable, venu du fond de son enfance (il avait alors sept
ans), et délivré par celle qui ne l’a plus jamais quitté.
« je m’appelle godeleine degroote, je suis morte dans un accident
d’auto non loin de folkestone en angleterre le huit août mille neuf cent
soixante-six
aussitôt j’ai su que je ne serais pas seule à mourir, que je ne
pouvais me détruire sans les autres, non par choix mais par amour
si on meurt à dix-huit ans on meurt par la famille »
Et c’est effectivement quatre membres de la famille, elle, la morte,
puis le père, et la mère, et enfin l’auteur, celui qui collecte les
voix, les douleurs et le ressenti de tous, qui vont ici se relayer,
chacun en un long monologue personnel, tendu, sans effusion, presque
clinique parfois, pour retracer ce que fut ce huit août tragique
(retour d’un après-midi de shopping londonien) et l’après fracassé qui
dure toujours.
« même lorsqu’elle est matérialisée par ta parole, je vis toujours à l’étroit dans ma disparition »
C’est de la place occupée par la disparue dans la vie de ses
proches, et de la façon qu’ils ont de donner corps à sa mémoire, qu’il
est ici question. Pour ce faire, Ludovic Degroote laisse en premier lieu
s’exprimer celle qui se sent tout à la fois désolée et coupable d’avoir
ainsi abandonné les siens en ouvrant en eux un vide avec lequel ils
devront composer tout au long de leur existence.
« ma disparition a créé beaucoup de souffrance et ça me fait mal,
j’aurais bien évidemment préféré vivre, faire vivre les autres, mais
j’ai pris toute la place, ma mort les a plongés dans ce lieu commun où
chacun se sépare, prenant appui contre son propre vide »
C’est en voyant vivre son père, abattu, ne se remettant pas, (« moi
le père ma parole a été confisquée à l’instant où j’ai su ce qu’il était
advenu de ma fille ») puis en interrogeant sa mère (« il est difficile
de ne pas revenir à cette histoire de ventre qui fait ma nature »)
pour connaître plus précisément ce qu’il n’avait pu saisir à l’époque,
qu’il réussit à reconstituer une trame qui, s’adossant à des faits
avérés ou supposés, se nourrit de la vie intérieure de chacun d’entre
eux.
« peut-être ne meurt-on pas chacun pour soi, mais les uns pour les
autres, ou les uns à la place des autres, puisque dès qu’elles tombent
des voix tombent en nous »
Il lui faut retrouver le timbre, la fragilité, le doute, les mots
pesés, le sens profond ou caché, la légèreté ou la gravité de ces voix
qui passent en lui. Les assembler lui permet de rendre toute sa
présence à l’absente. C’est la grande force de Monologue. Semblable à celle qui circulait dans Pensées des morts (Tarabuste, 2003). Et qui s’affirme totalement ici. Fragmentée, incarnée, ciselée par l’épreuve du temps.
« chacun nous vivons avec des polyphonies intérieures auxquelles nous
n’accédons pas toujours, comme si nous demeurions seulement à l’écoute
de nous-mêmes au lieu de nous ouvrir aux paroles qui nous traversent et
que nous ignorons le plus souvent »
Ludovic Degroote, Monologue, éditions Champ Vallon.
Ludovic Degroote, Monologue, éditions Champ Vallon.