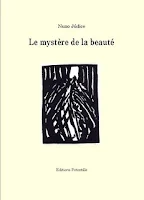Le tableau s’offre paisible et reposant. Le naturalisme y prend ses
aises. Un curé pose, assis au jardin, un bréviaire à la main, avec tout
autour de lui des fleurs et des choux. L’enclos où il se trouve
surplombe un village dont on distingue, dans une lumière qui est sans
doute celle d’un soir d’été, le dégradé des toits, des pignons et des
cheminées. Plus loin, se devinent champs et collines.
Le tableau s’offre paisible et reposant. Le naturalisme y prend ses
aises. Un curé pose, assis au jardin, un bréviaire à la main, avec tout
autour de lui des fleurs et des choux. L’enclos où il se trouve
surplombe un village dont on distingue, dans une lumière qui est sans
doute celle d’un soir d’été, le dégradé des toits, des pignons et des
cheminées. Plus loin, se devinent champs et collines.
Jules-Alexis Muenier a vingt-trois ans quand il peint La Retraite de l’aumônier ou Le Bréviaire, toile avec laquelle il obtiendra (lui qui fut l’élève de Gérôme) une médaille au Salon des Artistes Français en 1887.
L’œuvre appartient désormais au musée des beaux-arts de Cambrai et
c’est sur elle que Lucien Suel a choisi de jeter son dévolu pour en
proposer une lecture originale. Plutôt que de s’inventer critique d’art,
l’auteur de Mort d’un jardinier
(sensible, on l’imagine, à ce décor-ci) a préféré rester fidèle à sa
façon d’être et d’écrire. Il crée du mouvement et procède pour cela à
une vraie mise en scène du tableau en invitant trois personnages à
s’exprimer. Il appelle Dieu, l’aumônier et le peintre. Le premier
regarde l’homme d’église du haut de son perchoir céleste en le
remerciant avec un peu d’avance pour la qualité de son passage (qui se
termine) sur terre.
« Tu as consacré les unions, réconforté les malades, béni et enseigné
les enfants, rassemblé tes frères, aimé les âmes qui te furent
confiées. »
Le deuxième psalmodie et empile, pêle-mêle, quelques pensées,
principes ou faits anodins et réguliers en se préparant à rejoindre ceux
qui l’ont précédé dans la mort. Ses bribes sont entrecoupées de
réminiscences latines.
« Je me tais toute une vie est passée mon père disait tu traces ton
sillon tu te retournes au bout du champ c’est fini - ne savait ni le
jour ni l’heure - mal aux reins - mal aux fesses sur ce banc - Beati
pauperes spiritu - encore les hirondelles bientôt l’Afrique -
missionnaires – dictionnaires - mon bréviaire messe du matin - merci
Seigneur - demain savon à barbe - la poussière des morts je marche
dessus »
Quant au troisième, il revient sur la conception et le cheminement de sa toile en évoquant celui qui a posé pour lui.
« L’abbé Dambricourt fut heureux de mon succès au Salon de 1887. Il
me dit en souriant que le jury avait dû être sensible au contraste entre
la beauté du jardin et la décrépitude du personnage qui s’y trouvait ».
Chacun des intervenants s’exprime à tour de rôle et à plusieurs
reprises, dans des registres différents, procurant à l’ensemble une
force singulière, celle qui émane d’un tableau dans lequel Suel entre
presque par effraction, en devinant les propos de ceux qui ne sont plus
là pour témoigner, réussissant même à isoler puis à croquer le peintre
et son modèle sitôt la séance de travail levée.
« Je travaillais rapidement, sans parler, jusqu’à ce que l’intensité
de la lumière ait baissé au point où j’eusse été contraint de modifier
ma palette. Alors, j’arrêtais la séance. Le vieux prêtre décroisait les
jambes et posait son bréviaire sur le banc, puis, se redressant avec
peine, il se frottait longuement le dos. »
Lucien Suel : Le Bréviaire, Une lecture de La Retraite de l’aumônier de Jules-Alexis Muenier (1863 – 1942), éditions Invenit.