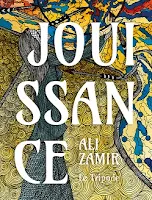Belle initiative des Éditions de l’Atelier de l’agneau qui publient, in
extenso, le dernier tome des œuvres complètes de Guennadi Aîgui. Les
poèmes, écrits entre 1986 et 2004, et édités à Moscou en 2009,
permettent d’entendre à nouveau la voix singulière, intuitive, simple,
empreinte d’un certain dénuement, s’approchant parfois du silence, de
l’un des poètes majeurs de la seconde moitié du vingtième siècle. Né en
Tvouvachie en 1934 et décédé en 2006, Aïgui a été publié en France dès
1976, grâce à Léon Robel, ainsi qu’un peu partout à travers le monde
alors qu’il était impossible de le lire dans son propre pays jusqu’en
1985, sa proximité avec Boris Pasternak n’y étant pas pour rien. Il a
longtemps vécu dans la clandestinité, n’étant visible que dans
l’underground russe.
« plus pauvres parmi les pauvres nous sommes
de ceux qui ne sont pas grand-chose
c’est ainsi que nous faisons tous deux bon ménage : l’un
joignant les Deux Bouts l’autre depuis toujours
Ouvrant la Marche »
Olga Sedakova, dans sa préface à l’édition russe, évoque une
« poétique de la pauvreté ». Celle-ci traverse en effet l’œuvre d’Aïgui
et l’amène à écrire avec concision, cherchant le mot juste pour dire ce
qui vibre en lui dès qu’il pose son regard sur les territoires immenses
qui l’accompagnent depuis l’enfance : les champs à perte de vue, la
plaine de la Volga, les neiges ou les moissons qui peuvent tout
recouvrir. Ce qu’il perçoit alors, c’est la fragilité de l’humain, la
sienne s’ajoutant à celles de tous ceux qui l’on précédé.
« que résonne le "je suis vieux" du champ habité du monde
moi je continuerai à voir à travers son filtre rose comme les glissements
des montagnes c’est ainsi que je verrai
poindre le filet d’eau qui murmure "je suis faible comme le crime"
parmi les vieilleries du monde »
Sa poésie est exigeante. Il la travaille au couteau. Ne perd jamais
de vue sa motivation première, qui figure souvent dans le titre de son
poème. Tout est ramassé en un noyau central qui doit beaucoup à son
regard, à son ressenti et à sa mémoire revivifiée. Il a une grande
capacité à s’émouvoir et ces moments de grâce, durant lesquels il se
sent en osmose avec son environnement, déclenchent son besoin
d’écrire. Cela naît de choses simples, d’un paysage, d’un dîner dans une
maison à la campagne, d’un village entrevu lors d’un voyage en train,
d’un champ au printemps, de « l’apparition de la mésange » ou du
bruissement des feuilles dans la forêt. Ou encore de la belle présence
d’un bouleau à midi :
« dans la brûlure de midi
soudain -
avec force
s’isole
le bouleau -
avec éclat – comme quelque Évangile :
(il se suffit à lui-même, il ne dérange personne)
il se dévoile – sans cesse :
se laissant feuilleter
(tout – "en dieu")
Cet ensemble conséquent nous permet de suivre Guennadi Aïgui pendant
les vingt dernières années de sa vie. Ce sont celles où il a enfin eu
l’autorisation de quitter la Russie et certains poèmes ont été écrits à
Berlin ou à Budapest. C’est dans cette ville qu’il s’est rendu lors de
son premier voyage à l’étranger, en 1988. Il le rappelle dans Dernier départ,
(texte qui avait précédemment été publié en bilingue par les éditions
Mesures, dans une traduction d’André Markowicz, qui fut d’ailleurs à
l’origine de la venue du poète à Rennes à la fin 1991). À Budapest,
Aïgui a passé beaucoup de temps devant le monument du sculpteur Irme
Varga dédié à la mémoire du diplomate suédois Raoul Wallenberg qui, en
poste en Hongrie durant la seconde guerre mondiale, sauva des milliers
de Juifs avant d’être arrêté par l’Armée rouge en 1945 (on le
soupçonnait d’être un espion au service des États-Unis) et de
disparaître à tout jamais.
« Le titre initial de ces écrits était "La main de Wallenberg" : le
geste de cette main, étrange-énigmatique, arrêté-"en mouvement",
s’invitait sans relâche dans mes brouillons. »
En cette ultime période de sa vie, Aïgui, outre ses voyages, continue
de tracer, de graver son empreinte poétique. Il lit, relit ceux qui
l’accompagnent depuis longtemps (Klebnikov, Mandelstam, Celan), reste
fidèle aux paysages qui lui sont familiers et aime les voir se
transformer à chaque nouvelle saison.
« et clairement chantées
sont les îles au-delà du village
comme issues du bonheur des herbes
parcourues par un chaud murmure »
Guennadi Aïgui : Toujours plus autrement sur terre, traduit du russe par Clara Calvet et Christian Lafont, préface de Olga Sedakova, éditions Atelier de l'agneau.