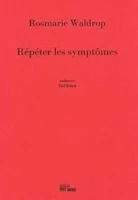Né en 1924 à Mineo, Giuseppe Bonaviri a
souvent placé sa ville natale, située dans la province de Catane, en
Sicile, au centre de ses romans. On la retrouve également dans La divine forêt,
livre publié une première fois en Italie en 1969. La cité perchée
apparaît dans un vaste territoire aux abords montagneux et vallonnés.
Le roman débute en un passé lointain, sans doute peu après le
big-bang. La terre sort à peine de son brouillard cosmique. Elle bouge,
se déploie, a déjà façonné crevasses et collines, ravins et pentes
abruptes, mers, torrents et rivières. Vallons et coteaux se couvrent de
végétation. Les herbes chuchotent et se parlent. Les arbres en font de
même. Tous ont un peu peur du vent et du soleil, ces dieux étranges qui
commencent à montrer leur force et leur pouvoir. Le narrateur vient lui
aussi de naître. Il a subi plusieurs métamorphoses et, après avoir été
plante de bourrache, le voici devenu vautour.
« Ce n’est pas tous les jours que l’on devient vautour, là-haut dans les terres de Camuti »
Il s’appelle Apomeo, déplie ses ailes, aime l’apesanteur, vole très
haut, aperçoit des êtres minuscules au ras du sol. Ainsi, ce lapin qui
entre dans son champ de vision sans se douter qu’il signe là son arrêt
de mort.
« Je fondis sur le lapin qui s’aplatit sans rien dire, et je lui
plantai mes serres dans le cou, en éprouvant un plaisir qui dépassait
tous les autres.
"Qu’il est mou", pensais-je.
L’animal s’était renversé sur la roche qui était blanche, calcaire ;
j’enfonçais davantage mes serres et je vous jure que je ne me sentais
nullement méchant, mais initié à une nouvelle forme de vie »
Apomeo apprend vite. Il mène une vie de rapace épanoui, multiplie les
escapades, survole roches, bosquets, amandiers et oliviers, s’offre
quelques battues quotidiennes et apprécie tout particulièrement le goût
des lapins, des lézards et des renards. Bientôt, il rencontre sa
compagne, Toina, et ne tarde pas à emménager avec elle, dans un « beau
trou vers le sommet des rochers, à Fiumecaldo ».
« Soyez heureux, soyez heureux, nous disait parfois un vieux hibou
qui se tenait tout seul dans son nid, sur un piton rocheux, non loin de
nous. »
Le jour où Toina, qui rêve d’un amour très intense, s’en va, c’est
Michele, le hibou presque centenaire, qui prend les commandes et décide
de guider Apomeo, pris de mélancolie puis de rage, pour essayer de la
retrouver. D’autres se joignent à eux. Il y a là Cratete, le merle,
Apollodoro, le rouge-gorge, Panezio, le pivert ou encore Antistène, le
grand duc, toute une communauté d’oiseaux solidaires qui appartiennent à
"l’école du caroubier", du nom de l’arbre où ils se rassemblent pour
échanger et méditer.
L’histoire, contée par Apomeo en personne, se concentre dès lors sur
la recherche de Toina. Le vautour et ses amis survolent Mineo et ses
environs et poussent jusqu’à la mer où Michele connaît du monde,
notamment Pirone et Fliunte, deux dauphins qui s’amusent à danser sur
les flots. Ils se posent sur le dos du premier et remarquent au loin des
embarcations chargées d’hommes, « des êtres tourmentés par l’erreur et
par les peines » que Pirone leur déconseille d’approcher.
Ces êtres, animaux étranges, inquiètent et font peur. Intuitivement, Apomeo
les sent capables du pire. Qui adviendra le jour où ces terribles
prédateurs s’empareront du feu pour le propager en brûlant arbres,
herbes, grillons, écureuils, oiseaux trop distraits et même quelques
enfants, surpris par les flammes alors qu’ils cueillaient des fruits
« au plus épais du micocoulier. »
« Il nous arrivait de voir des squelettes noirs d’oliviers – qui
abondaient en cette zone – d’où pendaient des oiseaux sans vie. Pour les
hommes c’était une véritable manne. »
Pendant ce temps, les recherches d’Apomeo se poursuivent mais
restent vaines. À la fin, il ne voit qu’un seul endroit, non encore
exploré, où Toina peut s’être rendue, en quête de nouvelles aventures :
la lune.
« La lune se levait, énormément grossie dans son diamètre, les bords
tout luisants. On avait l’impression qu’il suffisait de tendre une aile
pour pouvoir la toucher. »
Giuseppe Bonaviri, qui exerçait par ailleurs la profession de
médecin, est décédé en 2009. Il laisse une œuvre diverse et envoûtante,
celle d’un fabuleux conteur. Le suivre dans La divine forêt,
récit rare et réconfortant où prose et poésie s’assemblent
naturellement, est un vrai bonheur de lecture. Fasciné par la biologie
et persuadé que les hommes, les animaux, les plantes et les éléments
sont égaux et interdépendants, Bonaviri donne libre cours à un
imaginaire qui vibre entre ciel et terre et qui se nourrit de contes,
de fables, de légendes, de mystères et d’histoires ancrés dans les
mémoires ancestrales de son île natale.
Giuseppe Bonaviri : La divine forêt, traduit par Uccio Esposito Torrigiani, postface de Giorgio Manganelli, traduit par Philippe Di Meo, éditions La Barque.