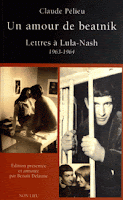C’est dans la ville de Catane, en Sicile, où elle est née en 1924, que
Goliarda Sapienza a passé son enfance. C’est celle-ci, retracée avec
fougue à travers portraits, rencontres et anecdotes et transcendée par
l’effervescence qui régnait alors tant dans la maison familiale que dans
la rue, qui sert de trame à ce roman autobiographique.
Elle y décrit avec passion, malice et feinte naïveté l’envie de vivre et le goût de la liberté qui l’animent et qui lui ont été transmis par ses parents. Son père, Giuseppe Sapienza, est avocat des pauvres et militant antifasciste et sa mère, Maria Guidice, socialiste radicale, est l’une des figures de la gauche italienne, directrice du journal Le Cri du peuple. Avant qu’ils ne se rencontrent, elle a donné naissance à sept enfants et lui en a eu trois d’un précédent mariage. Goliarda est née, tardivement, de leur union.
Elle y décrit avec passion, malice et feinte naïveté l’envie de vivre et le goût de la liberté qui l’animent et qui lui ont été transmis par ses parents. Son père, Giuseppe Sapienza, est avocat des pauvres et militant antifasciste et sa mère, Maria Guidice, socialiste radicale, est l’une des figures de la gauche italienne, directrice du journal Le Cri du peuple. Avant qu’ils ne se rencontrent, elle a donné naissance à sept enfants et lui en a eu trois d’un précédent mariage. Goliarda est née, tardivement, de leur union.
« Chez moi tout le monde avait toujours tant à faire. Tant et tant
qu’on était contraint soi-même de s’inventer mille choses à trafiquer, à
mener à bien, lire, jouer, parce que jouer et imaginer étaient aussi
considérés, chez moi, comme "un faire". »
Ses parents étant trop occupés, pris par les combats à mener, les
affaires à régler, les articles à rédiger, les réunions à préparer, son
éducation est laissée à la charge de ses frères aînés, Carlo, Ivanoe et
Arminio, qui s’activent pour l’initier, très tôt, aux textes
philosophiques, littéraires et révolutionnaires tout en lui inculquant
des valeurs sociales capables de déjouer celles de la culture fasciste
officielle, très présente à l’école. Le reste, elle l’apprend en ville,
dans la Civita, auprès des nombreux habitants qu’elle côtoie tel
Tato, le mendiant sans mains, ou Alessandro, son oncle, qui vient de
tuer cinq fascistes en subtilisant la matraque de l’un d’entre eux avant
de leur fracasser la tête à tous.
« Quand Alessandro eut fini de donner une leçon à ces messieurs, sa
grand-mère, tenant, de son bras tendu, la lampe au-dessus de sa tête
pour éclairer la scène – la nuit était tombée entre-temps –, cria aux
paysans qui avaient assisté en cercle, muets et tremblants, au combat :
"Et maintenant nettoyez le terrain de toute cette saloperie
qu’Alessandro a dû faire à cause de votre lâcheté. Allez, au
travail !" »
Son éducation se s’arrête pas là. Il lui suffit parfois de dialoguer
avec les repris de justice que son père emploie à la maison dès leur
sortie de prison pour en apprendre bien plus que tout un chacun sur la
vie, ses dérapages, ses à-côtés et ses coups du sort. Elle écoute Tina
la folle lui expliquer comment elle a tué sa sœur et son fiancé avec un
fusil de chasse parce qu’ils avaient couché ensemble et Zoé, "la nonne
du crime", lui conter, échevelée, la nuit où elle donna un coup de
couteau à sa mère et un autre à un carabinier. D’autres épisodes,
captés grâce à une insatiable curiosité naturelle, lui apprennent à
mieux connaître les ressorts de l’âme humaine.
« C’est ma mère qui parle dans ma tête, selon elle la mafia comme le
fascisme se trouvent à l’intérieur de nous-mêmes – vieil héritage –,
tapie, prête à nous entraîner vers le mal. »
Mais celui qui va la fasciner et prendre la plus grande place dans
son imagination, c’est Jean Gabin. Elle le découvre au Cinéma Mirone où
l’on projette Pépé le Moko et est instantanément emportée par la
prestance de ce caïd en cravate blanche et aux yeux bleus qui résiste
dans la casbah d’Alger. À peine sortie de la salle, elle adopte sa
démarche, sent une fierté monter en elle, s’identifie peu à peu à celui
qu’elle appelle tout simplement Jean et qui va l’aider en lui servant
de modèle pour affronter ceux qui lui tiennent tête.
« Revoir les films de Jean Gabin : je savais comment faire. En
fermant les yeux, je repassais une à une toutes les scènes sur l’écran
de la mémoire, toute puissante chez moi comme du reste chez tous ceux
qui gagnent leur pain et leur liberté au jour le jour. Pour être bandit,
voleur, ou simplement rebelle, il faut avoir par dessus tout de la
mémoire, autrement on est foutu. »
De la mémoire, Goliarda Sapienza n’en manque pas. C’est elle qui lui
permet de revivre ces années d’enfance et d’adolescence qui ont forgé sa
sensibilité dans l’entre-deux-guerres, à une époque où les membres de
sa famille se trouvaient régulièrement sous la menace des milices
fascistes et de la mafia. Moi, Jean Gabin est un livre plein de vie, de solidarité et de résistance.
Entrée à seize ans à l’Académie d’art dramatique de Rome, Goliarda
Sapienza a connu le succès au théâtre avant de tout abandonner pour se
consacrer à l’écriture. Elle est décédée en 1996. Son œuvre (que les
éditions Attila vont intégralement publier) n’a commencé à être
reconnue qu’à partir de 2005 avec la parution en France de L’Art de la joie (éditions Viviane Hamy).
Goliarda Sapienza : Moi, Jean Gabin, traduit de l’italien par Nathalie Castagné, éditions Attila.
Goliarda Sapienza : Moi, Jean Gabin, traduit de l’italien par Nathalie Castagné, éditions Attila.