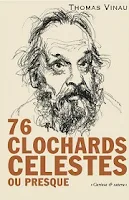"J'étais avec des yeux gris
ternis de tristesse quand je quittais l'occident
puis je donnai mes yeux à lécher
aux ânes croisés des confins des lacs
et ils bleuirent quand j'eus quarante ans
et vifs s'égayèrent azurés
frottés de roseaux noirs et dorés".
Louis-François Delisse,
Ode au Voyage et à Henri Michaux, Atelier de l'agneau, 2001.
En hommage à
Louis-François Delisse, né en 1931 au hameau frontalier de Gibraltar, entre Néchin (Belgique) et Leers (France) et décédé le 7 février à Paris, voici l'entretien qu'il avait accordé à Olivier Hobé en 2007 et qui fut publié dans la revue
Trémalo et sur le site des éditions Wigwam.
Olivier Hobé -
Louis-François Delisse, on dit parfois de vous que vous êtes un des
enfants terribles de la poésie française, on sait aussi que vos
écrits ont pu consoler un René Char parfois désabusé, on dit
beaucoup de choses…
Louis-François Delisse -
J’ai deux prénoms que j’ai tenu à lier ensemble mais ils ont
vécu chacun de leur côté. Louis était l’enfant sage, le bon
élève ; François pour les filles et les 400 coups. Avec Jacky
Dodin, nous avions en 44 retourné tous les panneaux de circulation
de l’armée allemande en déroute, à Roubaix et à la frontière.
François était aussi mon prénom d’enfant secret, d’amoureux
précoce.
Puis j’ai volontairement scandalisé Roubaix en
affichant mon amitié avec un repris de justice. Dans les cafés. Sur
les places publiques. Louis passait son bac à 14 ans. François
fuguait à Paris. A l’époque je signais François ma poésie, et
Louis mes scénarii pour les journaux d’enfants illustrés.
Quant
à René Char, il découvrit mes manuscrits chez GLM, à l’imprimerie
et encouragea vivement l’éditeur à tirer mes poésies du Soleil
total et du Vœu de la rose. Il envoya mes récits à Nadeau qui les
a ensuite égarés, selon Denis de Rougemont, dont ces Lépreux
souriants encore à paraître, à Rennes, aux éditions Apogée,
écrits il y a juste 50 ans !
Olivier Hobé - Qu’est-ce qui
fait de vous celui que l’on surnomme « Delisse l’Africain » ?
Est-ce votre devoir, accompli, d’alphabétisation et d’enseignement
à Niamey de 1954 à 1961, puis à Zinder jusque 1975 ; est-ce
votre description des rues africaines dans vos poèmes ou notes, vos
adaptations de poésie orale touarègue ?
Louis-François Delisse -
Rappelé à l’ordre par mon service militaire en disciplinaire
(pour insoumission à Metz), où par exemple on nous faisait tirer
sur des cibles avec turbans, j’ai vite mis à ma libération, en
avril 54, les bouts pour l’Afrique noire où je savais que je ne
serais pas rappelé.
Niamey était un camp militaire à cette
époque, du barbelé jusque sur ses arbres (pour les protéger des
chèvres) mais ses enfants étaient si beaux, son fleuve si vaste que
je finis par y rester sept ans. Les années où j’ai le plus écrit,
tout en me refusant à vivre en colon, à jouir en colon et militant
même pour leur indépendance.
Mais je découvrais aussi à la
bibliothèque de Niamey, les poésies touarègues notées par de
Foucauld de 1905 à 1917, je m’attachais à en reproduire le mot à
mot si vert, si vif, érotique. Puis limogé par la politique
scolaire, du côté de Zinder de 1961 à 1975, je recopiais également
beaucoup de poésie des Haoussa, celle surtout de leurs ornements
symboliques sur les demeures, les cuirs, l’orfèvrerie. Le Niger
était désormais soumis à des présidents militaires, la poésie en
péril.
Olivier Hobé - Vous êtes né
à Gibraltar, près de Roubaix. C’était prémédité ? Je
veux dire par là que votre lieu de naissance unifiait déjà, en
quelque sorte, l’Afrique et l’Espagne…
Louis-François
Delisse - Cette évocation du hameau de douaniers et fraudeurs où j’ai
grandi, est la source de la poésie en moi. Dès 5 ans, j’y
écrivais des lettres à ma mère éloignée, très vivantes. Puis au
Collège on me mettait en retenue pour lire « mes inventions »
littéraires. Mais il y avait un croisement dans ma famille, entre ma
mère alsacienne et mon père frontalier…
Olivier Hobé - Oui, ce
croisement c’est vous…
Louis-François Delisse - La
frontière passait au milieu de leur lit, où me concevant, ils
allièrent mes deux prénoms. Mais aussi, dans le pré de cette
fermette il y avait une borne de l’empire de Charles Quint, du
temps où les Flandres furent espagnoles. Je n’ai pas pu apprendre
l’allemand mais, voyageant en chemin de fer en Espagne, l’espagnol
me fut presque aussitôt une seconde langue, au moins à l’écrit
où je me suis occupé à le traduire avec passion dès
1954.
J’emmenais Alberti en Afrique pour le traduire, j’emmenais
toutes les traductions de poésie espagnole de GLM, avec la poésie
grecque des Hymnes homériques et des Epigrammes. Quand j’eus à
enseigner la philosophie au Niger, c’était les Héraclitéens et
Plotin mes phares, et Césaire, Camus.
Mais je me passionnais
davantage pour la poésie des Touaregs et les merveilleuses poésies
des Peuls et autres négro-africains, dans les versions d’Hampaté
Bâ, de Lyliane Kesteloot (une native de mon village belge !) et
de Marguerite Dupire pour les Bororos.
Celle-ci devenue
« l’hirondelle du Désert » pour les colons qu’elle
scandalisait, vivant sous les tentes des nomades, venait du côté
François de ma vie, de cette école des filles des Sœurs de Roubaix
où j’envoyais mes premières poésies aux plus jolies.
Olivier Hobé - A la lecture de
vos dernières Notes d’Hôtel récemment parues aux éditions
Apogée, on vous voit au bord des lavoirs du Niger, près du cinéma
Cokino de Zinder ou bien encore emmailloté du textile flamboyant de
la ruelle du Galon d’eau ; votre nourriture c’est celle du
chant des andalous, celle de ce soleil qui parfois descend très
rouge…tout ceci paraît d’ailleurs très naturel au sein même de
l’écriture, par son tissage même.
Louis-François Delisse - J’ai
écrit ces Notes par association mentales de 3 ou 4, en une
suite immédiate qui me venait à la lecture des premières que Jimmy
Gladiator publiait dans son brûlot L’hôtel Ouistiti. Puis
j’ai poursuivi de la même manière, je dactylographiais chaque
série, mes doigts s’embrouillent depuis mais j’ai certainement
encore beaucoup de suites à en donner !
La chronologie est
fournie à la fin, et le lieu, je suis un disciple de Gilbert Lely
ici, et de sa poésie sadienne où il s’agissait de rapporter le
lieu, l’heure, l’image et l’émotion vécue, de chaque poésie.
Mes éditeurs refusent ces précisions, qui selon eux alourdiraient
le texte. C’est pour moi condition d’authenticité.
Tous ces
récits ont été vécus, même les plus banals, et au passage
François Delisse conte aussi sa part de l’ombre, braque une
lumière sur certains de ses démons. Tels dans les chants andalous
noirs du Cante Jondo que je ne cesse de traduire.
Olivier Hobé - Au bout du
compte, il y a chez vous François et Louis, la poésie et la
traduction de la poésie, des déserts et des voies pavées, des
possessions, des processions même, cela fait un parcours…
Louis-François Delisse - Je
suis parti des décadents, des Noctes pour la Dent d’or, ma
première publication en 1951 (éditions Debresse), où le symbolisme côtoie Verlaine et
Rimbaud. Puis la jeune poésie que je découvrais à Paris, de banale
à brillante, de la papoésie et l’apoésie à Malcolm de Chazal et
Césaire, m’aurait découragé sans ma décision d’aller
l’exercer au Niger, où j’ai écrit Soleil total presque
d’un trait, en 16 mois.
Je l’adressais à GLM dès 1956, GLM
qui m’avait été révélé pendant mon service militaire par un
libraire de la place ducale à Nancy. Puis j’écrivis, presque
possédé, au fleuve, où je vivais mes nuits, à Yentalla,
« dieu-tige » en somme, mais ce grand manuscrit m’a
longtemps échappé. Je l’avais recopié en 3 exemplaires à
Roubaix, chez Albert Derasse qui était mon agent pour la publication
de Soleil total chez GLM. Mon exemplaire à Niamey était au
deux tiers brûlé par une grenade lancée dans ma case par l’OAS
en 1960.
Celui de GLM, qu’il prêta, ne lui fut pas rendu
(Gallimard, à qui j’avais refusé Soleil total ?) Et
Derasse, partant pour l’Afrique à son tour, cacha si bien son
exemplaire qu’il ne le retrouvait qu’en 1997, à Roubaix, et il
fut aussitôt publié à Brive, chez Myrddin, par Pierre
Peuchmaurd.
L’anthologie de mon Vœu de la rose, poésies
de 1950 à 1960, chez GLM, n’empêcha pas le manque de
« dieu-tige » comme cause de mon silence éditorial
jusque 1990, où je publiais mon dernier recueil préparé au Niger,
Paysages avec bestiaire et pierres tombales, à l’Embellie
roturière.
Mon retour du Niger, en 1975, m’a été imposé,
arraché. Ma poésie a failli en disparaître, sauf en anglais ou
espagnol…J’ai presque plus traduit qu’écrit, depuis.
Olivier Hobé - Louis-François
Delisse, quels sont aujourd’hui vos projets d’édition,
d’écriture, de voyages peut-être ?
Louis-François Delisse
- Hélas, je ne puis plus voyager que dans ma tête –on m’a
hospitalisé chez moi, et retiré même ma carte de bus, je suis
souvent au jardin Simone Weil, avec les enfants et les oiseaux, avec
des personnes très âgées mais qui ont beaucoup vécu, Lucienne qui
fut modèle de Matisse et secrétaire de Neruda ; ses cendres
viennent d’être dispersées, avec son long passé d’anarchiste,
au Mur des Fédérés, à ses 101 ans.
C’est donc dans ce
jardin que je voyage, tandis que 2008 verra enfin paraître mes
Lépreux souriants, les cinq récits de ma vie à Niamey
(1954-61) et ma deuxième anthologie (après Aile elle mon
« livre nègre » composé de neuf recueils écrits au
Niger) Le Logis des Gémeaux, autres poésies d’avant et
d’après le Niger, mon « livre blanc » si l’on veut.
Et puis, je pourrai m’étendre, publier cette Fable de
Polyphème et Galatée, ou encore de nouvelles notes de
voyage…
Étendu, au jardin ou au lit, j’écrirai encore des
lettres et chacune de ces lettres aura sa poésie épistolaire
originale, comme Myrddin vient d’en publier la première suite dans
sa collection La part de l’eau.
Olivier Hobé - Louis-François
Delisse, je vous remercie. Puisse le dieu-tige vous animer de longs
jours encore.
Louis-François Delisse - Je
vous le fais ?
Olivier Hobé - Le dieu-tige ?
De Louis-François Delisse,
les éditions Wigwam ont publié
De fleur et de corde (2006) et les éditions
Apogée Notes d’hôtel (2007) et
Les
Lépreux souriants (2009) (dans la collection "Piqué
d’étoiles").
Parmi les autres publications de L.F. Delisse :
Soleil total (GLM, 1960),
Le Vœu de la rose (GLM, 1961),
Procès de la fleur (Myrddin, 1993),
Paysages (L'embellie rôturière, 1994),
D'un désert l'autre (Le Grand Hors-jeu, 1995),
Dieu-tige (L'Air de l'Eau, 1998),
Poésie amoureuse des Touaregs - avec Zahara Ag Mouddour, (Le Corridor bleu, 2000),
Aile, elle (Le Corridor bleu, 2002)
Tombeaux (Myrddin, 2005),
De la mort du lion (Les Vanneaux, 2005),
Le Logis des gémeaux (Le Corridor bleu, 2011)