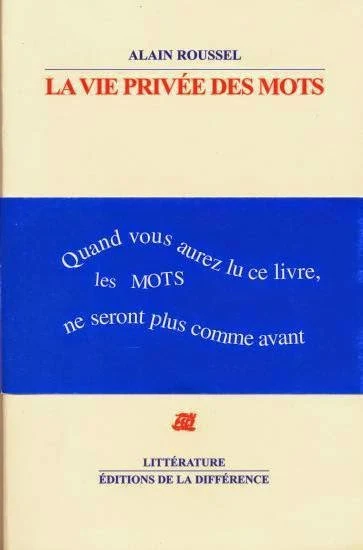En une succession de tableaux brefs et animés, Georges-Henri Morin
invite son lecteur à sillonner un pays où le temps semble s’être arrêté.
Le récit débute à Zurich puis se déplace à Belgrade et à Titograd
(l’ex-capitale du Monténégro) avant l’arrivée au poste frontière et
l’entrée sur le territoire albanais “où sont purifiés tous les
pneumatiques qui ont parcouru les sols étrangers et sont susceptibles
d’introduire la fièvre aphteuse”.
« Deux hommes se font face dans ce halo artificiel. La barrière
maintenant baissée raie leur verticalité. Le garde-frontière, un jeune
soldat tout engoncé dans son uniforme de type chinois, immobile,
mitraillette en mains, interpelle son supérieur. Il fixe au loin,
évitant le regard de l’officier. Première représentation pour moi d’une
pièce immuable, ordonnancée de manière strictement géométrique. »
Au fil de son périple, l’auteur, qui essaie de saisir un peu de vie
concrète autour de lui, se rend assez vite compte de la difficulté qu’il
y aura à nouer ici de vrais contacts. Il lui faudra biaiser, éviter de
montrer trop de curiosité et lui préférer une approche volontairement
calme et distanciée. C’est en affichant cette apparente nonchalance,
celle du voyageur qui ne se formalise pas plus de la présence constante
de la Fiat blanche de la Sigurimi (la direction de la sécurité de
l’état) devant ou derrière son propre véhicule que des dos courbés des
prisonniers au travail dans les champs, qu’il peut espérer toucher la
réalité d’un pays où autorité, peur et paranoïa restent étroitement
liées.
Il relate, à travers ses carnets, et avec parcimonie, sans jamais
forcer le trait, des scènes ou des rencontres qui permettent de
judicieux retours sur la société albanaise en 1987, autrement dit à un
moment très particulier de son histoire, deux ans après la mort d’Enver
Hoxha et quatre ans avant la chute du communisme. La vie à Tirana, telle
qu’il la perçoit dès son arrivée, paraît lente et mécanique, dictée par
les impératifs du quotidien et l’omniprésence de la police.
« Partout ce soir, dans les rues du vieux quartier, des bruits de
hachette coupant menu des cagettes et quelques planches arrachées on ne
sait où. Des enfants s’activent dans l’ombre. Une ville muette parle :
elle s’apprête à se chauffer. »
Çà et là, au bord des routes, il note l’avancée lente de groupes de
quelques personnes qui marchent sur les bas-côtés, ombres lasses
traînant en lisière de nuit et regagnant des localités où les maisons
basses se cachent derrière des arbustes. La monotonie paraît de mise. Il
observe, cherche des reflets de lumière dans la pénombre, les trouve
hors des chemins balisés, dans le regard de ceux qui viennent vers lui
en se laissant photographier. Sinon, seuls les endroits plus
touristiques, telles les ruines romaines de la cité d’Apollon ou la
ville de Durrès au bord de l’Adriatique (où les dignitaires du régime
prenaient leurs quartiers d’été), ou encore celle de Krujë, “ville
symbole de Scanderberg, qu’Ismaël Kadaré évoque dans Les Tambours de la pluie ” sortent un peu de l’hiver pour ouvrir une part de leur passé aux rares visiteurs.
« Dissimulés sous les arbres, un peu à l’écart du site archéologique
de Butrint, le pavillon de chasse d’Ali Pacha, une vieille tour massive.
Le vieux lion tarde à revenir des montagnes d’Épire. »
C’est là, à l’extrême sud du pays, à proximité de la frontière
grecque, là où Cicéron avait ses habitudes, et un peu plus tard sur le
front de mer à Sarandë que G.H. Morin clôt ses balades hors de Tirana.
Il en repart avec des esquisses, des croquis, des
fragments de proses ciselées, propices à la suggestion.
« La mer bat calmement la jetée de Sarandë. Cette nuit qui tentera
une traversée clandestine vers Corfou qui apparaît – disparaît au bon
vouloir des éclairs ? »
Georges-Henri Morin : Carnets oubliés d’un voyage dans le temps, éditions Ab irato.
Georges-Henri Morin : Carnets oubliés d’un voyage dans le temps, éditions Ab irato.