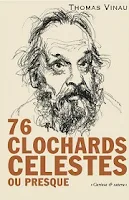Juillet 2015. Une voiture roule sur les routes départementales qui
sillonnent les puys d’Auvergne. Elle s’arrête fréquemment, sur le
parking d’un restaurant ou d’un hôtel, avant de repartir à l’aventure,
allant des monts du Forez aux plaines du Poitou, dans un "road
movie" que le conducteur (et narrateur), écrivain à la cinquantaine bien
entamée, souhaite libre et improvisé. Il voyage en compagnie d’une
jeune femme, vingt ans tout au plus, qui semble bien réelle et délurée.
Il ne l’a pourtant inventée que le mois précédent, alors qu’il était
assis sur la banquette de moleskine d’une brasserie parisienne. Il l’a
aussitôt prénommée Palombine, en hommage à Plombagine, "la fée du
Condurango" qu’évoquait naguère Léon-Paul Fargues.
« Elle est Palombine, aérienne et claire, manifestement colombe à la
ressemblance du Paraclet, si tant est qu’elle existe et ne se résout pas
en une fiction de pure utilité romanesque, jeune fille censée
m’accompagner dans mon périple et m’évitant le soliloque ».
Elle va devenir bien plus que cela, prenant rapidement toute sa place
et donnant à l’écrivain, qui ressemble beaucoup à Lionel-Édouard
Martin, quelques clés pour entrer dans ce monde actuel qu’il a quelque peu délaissé en s’arc-boutant sur un passé chargé de
nostalgies. Elle l’appelle affectueusement Lio-Lio et lui assène, avec
ses mots à elle, qui n’ont rien à voir avec les siens, quelques vérités
qui tournent plus autour du bon sens (qu’elle manie à la perfection)
que de l’intellect (dont il a appris – et ça tombe bien – à se méfier).
Un jeu, teinté d’une sorte de légèreté, se met ainsi en place. Deux
générations, deux façons d’être et d’appréhender la vie s’expriment
sans vraiment s’affronter. Lionel-Édouard Martin conduit son récit à sa
main, le frottant aux paysages, à l’étymologie des noms de lieux, aux
plaisirs du palais et à certains faits rattachés à l’histoire des
localités traversées. Il aime le passé sans être de ceux qui
prétendent que tout allait mieux avant. Sa Palombine est là pour le
rabrouer s’il déraille. Ce qu’il ne fait pas. S’il lui arrive de se
moquer de lui-même et de ses clins d’œil dans le rétroviseur (il revoit
alors, pêle-mêle, en un éclair, un lapin éborgné pendu à l’envers, une
vieille morte au bourg de Chailly, un couple d’escargots coïtant sur une
berme détrempée) c’est pour mieux revenir au présent, s’y promenant
avec, empilés dans sa besace, un tas de souvenirs et de livres qui
l’ont fait grandir.
Les dialogues fusent. Qui rythment une narration bien moins
désinvolte qu’il n’y paraît. L’écrivain la manie à la perfection. Il
s’y montre à son aise, brouillant les pistes ou clarifiant les choses,
selon l’envie ou la nécessité, ou selon l’interlocuteur qui lui fait
face, tel cet imprimeur-éditeur au verbe maniéré qu’il visite en cours
de route, ou ce concepteur d’événements culturels pour happy few qui
l’invite à lire ses poèmes en public en région parisienne, là où va se
terminer une balade qui semblait pourtant devoir se poursuivre
longtemps encore. Il suffira d’une page, écrite au cœur d’une flaque
rouge sang, au couteau sur un trottoir de banlieue , pour que tout
s’écroule. Manière de clore un rêve qui n’a peut-être pas eu lieu. Et de
dire adieu à un personnage qui disparaît brutalement, laissant une
empreinte légère, une belle clarté, une joie de vivre, tant dans les
mémoires que dans l’œuvre (forte) de celui qui, avant de nous réserver
ce coup de massue, nous aura permis, une fois encore, de flâner à ses
côtés sur les berges de la Gartempe, cette rivière qui coule souvent
dans ses livres.
Lionel-Édouard Martin : Icare au labyrinthe, éditions du Sonneur.
Lionel-Édouard Martin : Icare au labyrinthe, éditions du Sonneur.