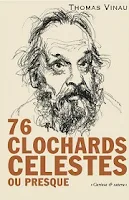Le roman, quand il met en scène des artistes disparus, réussit parfois à
percer des secrets et à éclairer des zones d’ombre que ne parviennent
pas à saisir obligatoirement l’essai et la biographie. Ainsi des liens
étroits qui unissaient, dans le dernier quart du dix-neuvième siècle,
le peintre François-Auguste Ravier (1814-1895) et l’industriel et
photographe Félix Thiollier (1842-1914). Si de nombreuses lettres
échangées entre eux permettent de témoigner de ce que fut leur amitié,
on ne s’attardait, par contre, pas vraiment sur leurs caractères bien
trempés, sur leurs parties de chasse communes, sur leurs joutes
verbales, sur leur désir de se surpasser et sur ce même élan créatif qui
allait les faire, l’un et l’autre, tout plaquer pour s’isoler et se
consacrer uniquement à leur art. Cela, seul un roman pouvait espérer le
toucher du doigt, pourvu qu’il se donne assez d’espace et de liberté
pour oser inventer, embellir et même falsifier certains pans de réalité.
C’est ce que fait ici, avec finesse, aplomb et légèreté, tout en
s’appuyant sur une solide documentation, Jean-Noël Blanc.
Il suit les deux hommes à la trace. Du début à la fin. De leur
enfance jusqu’à leur mort. L’un est né à Lyon et l’autre à
Saint-Étienne. Trente ans les séparent. Ils n’appartiennent pas à la
même classe sociale. Thiollier est issu d’un milieu aisé. Photographe
estimé, à défaut de devenir le peintre qu’il envisageait d’être, il est
littéralement subjugué quand il découvre, un peu par hasard, l’œuvre de
Ravier. Il pense à Constable, à Turner, à Corot. « Une telle fougue dans
les ciels, cela ne s’oublie pas ». Il lui écrit, va le voir là où il
s’est retiré, à Morestel, au fond du Dauphiné, et n’aura, dès lors, de
cesse de faire connaître ce peintre cabochard qui n’a pas plus envie
d’exposer que de vendre et qui passe son temps à traquer les lumières du
jour.
« Je continue à suivre ma folie – nous avons eu deux ou trois jours
de vent du midi qui ont exaspéré ma palette – j’ai des fringales de ciel
– c’est l’infini – je médite les drames de la lumière, j’essaie de
piéger le fugitif, d’attraper le brouillard argenté – il y a des heures
où personne n’a vu ce que j’ai vu. »
Thiollier, qui voyage beaucoup, allant de galeries en ateliers,
nouant des liens avec de nombreux peintres, achetant au passage beaucoup
d’œuvres, comprend très vite que Ravier, qui peint les ciels comme
personne, n’a rien à envier aux impressionnistes. Il en est même l’un
des précurseurs. Il convient de le faire savoir. Il ne va pas lésiner
pour tenter d’y parvenir, en multipliant les contacts, en établissant et
en publiant la première monographie du peintre dont il deviendra plus
tard, après sa mort, l’exécuteur testamentaire.
« Il faut démarcher, trouver des clients. Non, clients n’est pas le
mot approprié : l’affection et l’amitié demandent mieux qu’un négoce
anonyme. Il n’alerte donc que ceux qui aimaient le vieux peintre : des
acheteurs dignes de Ravier, dit-il. Il en connaît déjà suffisamment pour
écouler des pièces. Il vend par lots : quinze, vingt, plus encore. »
Cela ne l’empêche pas de continuer à photographier. Sans autre
ambition que de restituer ce qu’il voit : les paysages, les terres
noires, les ciels tourmentés mais aussi la ville, les mines, les forges,
les lieux industriels. Il est en train, mais ne le sait pas, et ne le
saura jamais, de devenir l’un des pionniers et des maîtres de la
photographie.
« Il ressemble à un Moïse sculpté par Michel-Ange, dit un flatteur.
Thiollier secoue la tête quand on lui rapporte ce propos, quel imbécile a
dit cette ânerie ? Moi, une statue ? A-t-on jamais vu une statue aller
blaguer avec un fossoyeur comme je le fais au cimetière de la
Tour-en-Jarez. »
Il devient aussi bourru que Ravier et aura, tout comme son ami, et
comme tous les solitaires qui n’entendent pas se plier aux exigences de
tel ou tel milieu, bien du mal à entrer dans la postérité. Jean-Noël Blanc,
en s’attachant à leurs parcours, en les faisant revivre plus d’un
siècle plus tard, leur rend, avec ce roman particulièrement prenant,
dont l’édition est augmentée de nombreuses reproductions, un très bel
hommage. Il leur redonne, tout simplement, la place qui devrait être la
leur dans l’histoire de la peinture et de la photographie.