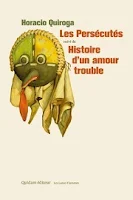Pas facile de croquer la vie avec un appétit d’ogre quand on a été élevé
par une mère éprise de religion, surtout quand la dévotion s’attache à
l’une des branches les plus radicales de la chrétienté, celle qui
regroupe les Témoins de Yahweh, une congrégation de prêcheurs, adeptes du
porte-à-porte, qui prédisent et préparent la prochaine fin du monde.
Comment se construire quand on a baigné là-dedans depuis son plus jeune âge, avec en prime un père absent ? C’est bien ce que se demande Christophe Cordier, auteur de BD plus connu sous le nom d’ÉphèZ.
Comment se construire quand on a baigné là-dedans depuis son plus jeune âge, avec en prime un père absent ? C’est bien ce que se demande Christophe Cordier, auteur de BD plus connu sous le nom d’ÉphèZ.
« Mon premier souvenir remontait à mes trois ans, un sale souvenir
malgré toute l’eau qui l’entourait : le baptême de ma mère. J’avais vu
des hommes l’empoigner au bord d’une piscine, la forcer à s’enfoncer
jusqu’à la taille. J’avais cru qu’il la noyait sous mes yeux. Je n’avais
pas compris son sourire triomphant quand ils l’avaient ressorti du
piège toute mouillée. »
Trente ans plus tard, alors qu’il pensait en avoir à peu près fini
avec Yahweh, la fin du monde et l’arrivée imminente de l’énigmatique
Armaguédon, plusieurs événements imprévus vont venir lui démontrer le
contraire. L’influence de sa mère n’a pas faibli. Elle infuse en secret.
Elle le corsète, détermine quelques unes de ses décisions et continue
d’empoisonner ses réflexions.
L’élément déclencheur est un accident de la circulation. Un jour, sa
mère, s’en allant prêcher, est heurtée par une voiture. Elle se retrouve
au sol. Ses papiers de prédicatrice voltigent dans la rue et finissent
dans le caniveau. À l’hôpital, la décision de faire une transfusion se
pose très vite. Or, chez les Témoins de Yahweh, on ne rigole pas avec
ce genre de chose.
Ils « étaient connus pour leur refus de toute transfusion. C’était
leur spécialité, leur façon de se démarquer des autres sectes. »
Si les circonstances vont aider ÉphèZ, le narrateur, à se sortir de
ce mauvais pas sans trop se mouiller, d’autres faits vont s’enchaîner, à
rythme soutenu, lui confirmant que sa vie, même auréolée d’une petite
aura de dessinateur reconnu, prend tout simplement l’eau. Il n’a pas la
sagesse de son chat Franquin. Il voit rouge à tout bout de champ. Les
relations qu’il entretient avec le monde extérieur et avec les rares
personnes qui lui sont proches ne sont pas au beau-fixe. Et
l’instabilité qui s’empare de lui ne va pas aller en s’arrangeant.
C’est cette lente descente – et ses soubresauts irrationnels – que
Frédérick Houdaer suit pas à pas. Il le fait avec méthode, en
choisissant le détail qui fait mouche et en usant d’une narration très
vive, très maîtrisée, avec humour et esprit caustique, en multipliant
les portraits au vitriol et les situations cocasses (et parfois
violentes) tout au long de ce roman diablement efficace.
Frédérick Houdaer : Armaguédon strip, Le Dilettante.