C’est sur un clin d’œil discret, qu’il n’aurait
pas désavoué, que se terminait l’avis de décès le concernant, paru dans
Le Monde en date du 17 avril 2014 :
« ni fleurs, ni couronnes, quelques radis bleus ».
Il ne reste désormais que ses livres pour accompagner les lecteurs
orphelins qui se demandent pourquoi il les a abandonnés si sèchement,
alors que l’aube n’était pas encore levée, en ce jour d’avril qui
s’effrita avant même d’avoir commencé. Eux seuls consentent à nous
donner des nouvelles de celui qui disait être né le jour de la
Saint-Isidore, en 1947, 1948 ou 1952, (il butait régulièrement sur
l’année) tandis qu’il bruinait sur les quais de Saône à Lyon. De ces
livres, se détache la trilogie titrée Une histoire (la sienne, écrite en pointillés et revivifiée au contact de beaucoup d’autres) qui comprend Je ne suis pas un héros, Toute une vie bien ratée (conçu pour distraire Music, son chien, son « camarade enchanteur ») et L’éternité est inutile.
Tout un programme pour un dilettante qui espérait n’être venu sur terre
que pour déguster mets, vins et mots, pour lambiner, se distraire, se
balader, s’envoler par dessus mers et paysages pour boire un daïquiri
glacé avec le leader Maximo à La Havane, s’amuser en rigolant avec un
koala suspendu à une branche dans une forêt australienne ou fumer un
calumet bourré d’herbes télépathiques avec les derniers Apaches
d’Amérique. C’était sans compter sur les velléités de son imaginaire en
ébullition. Un diable créatif, mangeur de temps libre, grand dévoreur de
farniente, dissimulé au creux de son être, lui ordonnait de s’activer
en racontant des histoires. Peu importe lesquelles, pourvu qu’elles
parviennent à transcender la morosité du quotidien. Il se devait de
noter ce qui lui semblait sortir de l’ordinaire, tel ce geste sûr qui
l’amena, un soir d’hiver, à délivrer un ange aux ailes prises dans le
grillage de clôture de son jardin ou ce réflexe, presque instantané, qui
fit de lui un héros le jour où il se mit à tirer comme un fou sur les
rênes de deux attelages tractant des charrettes pleines de chiens
enragés (et affamés) pour qu’elles n’aillent pas s’écraser au milieu
d’une cour d’école en pleine récréation. Aux premières loges de ces
aventures, qu’il restitua le plus fidèlement possible, trônaient ceux
qui lui ressemblaient : les humbles, les silencieux, les voyageurs
immobiles, les laissés pour compte.
On embarque dans ses récits en y montant prestement, comme le
faisaient jadis les hobos du rail qui grimpaient en douce dans les
trains de marchandises qui traversaient les États Unis. On se coule
dans le ressac verbal qu’il a initié et qui lui permettait d’inventer
des scènes dans lesquelles, en virtuose, en adepte des mots justes
savamment mis en forme, il faisait mouche en contant des morceaux
d’existence qu’il rehaussait d’un cran grâce à l’entrée, dans son
premier cercle, de quelques énergumènes aux parcours imparables.
Certains sortaient de son cerveau, d’autres s’échappaient de la mémoire
collective et d’autres encore, plus familiers, rôdaient dans les
environs de Lyon ou de Carpentras (où il vivait dans une maison
baptisée « La salamandre »). Ceux-là ne se contentaient pas de regarder
par dessus son épaule. Ils pénétraient dans ses textes et parfois même
lui dictaient quelques bribes. Il les amadouait en leur offrant le gîte
et le couvert. Il les incitait (il y avait là Durruti, le curé d’Ars,
l’aviateur Blériot, le torero Paquirri et sa grand-mère Jeanne Autin) à
discuter révolution et anarchie avec lui avant de prendre le frais sous
la tonnelle en s’égaillant le palais à l’aide d’un chablis
Montée-de-Tonnerre enjoué et arrogant. Il distillait des séquences
autobiographiques qui allaient de ses débuts tremblotants (il était
l’unique rejeton d’une mère péripatéticienne et d’un père volatilisé)
jusqu’à la découverte de la lecture, puis de l’écriture. Il y gravait
une mélancolie désabusée qu’il relevait, en pessimiste lucide, d’une
pointe d’humour noir, transformant la désespérance en colère pailletée
de pudeur.
« Ayant échappé aux turpitudes de l’enfance, m’étant affranchi de
la tyrannie des chefs, je rattrapais la vie que l’on m’avait volée. »
Lui qui prétendait n’être bien nulle part se sera agréablement aéré
les neurones. Si quelques rapides repérages l’ont transporté en roue
libre de « l’avenue Goffette » à l’improbable « place Pierre Overney »,
ses périples le portaient plus sûrement vers des contrées dont les noms
parfois l’attiraient et où il savait d’avance (même s’il ne s’y
rendait que par la pensée) qu’il se sentirait chez lui, comme poisson
dans l’eau, gobant l’imprévu en un éclair, cueillant des fleurs vives
dans des zones sensibles, aussi à l’aise à Bâton Rouge en Louisiane que
dans le désert de Kalahari. Il lui suffisait de trouver un bon capitaine
(ce pouvait être Brautigan ou Carver) pour déclencher en son
subconscient une escapade oscillant entre fantaisies joyeuses et
petites absurdités revigorantes.
Pourquoi resté cloîtré chez soi des mois durant alors qu’en ouvrant
une frêle écoutille dans sa tête il pouvait, à la seconde, s’en aller
respirer l’air du large en marchant d’un pas léger, en sandalettes, sur
les quais de Zanzibar ?
Pourquoi espérer indéfiniment des nouvelles du fin fond du Montana (où
il ne connaissait d’ailleurs personne) alors que les Rocheuses étaient
là, à portée de regard, n’attendant que le crissement du stylo sur la
feuille pour offrir leurs contours enneigés à celui qui n’aurait bientôt
plus qu’à tracer quelques pistes en lacets dans la poudreuse pour
accéder aux premières habitations ?
Il guettait le moment de bascule, l’heure où le coucou sort de
l’horloge, l’instant où l’improbable balaie la réalité. Il écrivait,
racontait, tissait des liens entre un point et un autre et pressentait
d’emblée que c’était dans cet entre-deux que se cachait l’aventure.
C’était à ses yeux la seule solution pour rendre la vie (trop souvent
friable comme une gaufrette placée entre les dents de lapin du destin)
un peu plus solide. Alors il filait dare-dare ou peinard, avec en point
de mire le sommet du Ventoux ou les dentelles de Montmirail. Il suivait
l’instinct et l’humeur du moment, promettait à Madame Loulou, à Renée, à
Ginette et à tous les autres, d’être de retour chez Brunetti pour
l’apéro du soir en grignotant des « radis bleus ».
« C’est dans les cafés que j’ai appris à lire, que j’ai forgé mes
armes, et mes humanités je les ai faites sur la banquette du fond de la
Friterie-bar Brunetti, pas très loin du poêle à charbon. »
S’il aimait rappeler ce qu’il devait aux bars sombres, aux zincs
cuivrés, aux boui-boui bigarrés, à l’humilité mais aussi aux coups de
gueule salvateurs de ceux qui les fréquentaient, il n’hésitait pas à
attirer l’attention sur d’autres lieux de convivialité qui ont également
beaucoup compté pour lui, en l’occurrence les multiples revues de
poésie qu’il lisait et où ses textes étaient publiés. Il leur vouait
une indéfectible admiration. Pas de création sans ce formidable vivier
d’écrits en cours qu’étaient, années 70, 80, 90, ces havres de papier où
nombre de fidèles, de flâneurs en rupture, de solitaires n’appartenant
à aucune chapelle, de sonneurs de vers sans pieds, de pointillistes
nerveux, d’inconnus contents de l’être et de le rester se donnaient
périodiquement rendez-vous.
« Parfois je confiais un poème, une nouvelle, à l’une ou l’autre
des revues littéraires qui foisonnaient alors sans s’embarrasser de
tirages confidentiels ; souvent je recevais en échange la sympathie de
lecteurs bienveillants qui m’encourageaient à poursuivre. »
S’il est un mot qui revient dès que l’on évoque l’homme qui
n’hésitait pas à effectuer de fréquents retours en arrière, ne serait-ce
que pour écouter Fréhel, « la reine des Apaches », chanter Du gris
ou revoir le poète Jean Follain sortir un peu ivre d’un bateau-mouche
pour rejoindre la rue des Tuileries, c’est bien le mot « fraternel ». Il
l’était évidemment. Et tout autant malicieux, espiègle, fidèle en
amitié. Il parlait peu de ses récits. Bravait la camarde et son envoyé
très spécial, « le cancer des bronches ». Disait son affection pour
l’éditeur Jean Le Mauve et sa fascination pour le peintre Ronan Barrot.
Il s’amusait à s’inventer un père apiculteur dont il avait,
prétendait-il, pris la relève (certains lecteurs ne manquaient pas de
lui demander qui s’occupait de ses ruches quand il partait porter sa
poésie en bibliothèque ou en librairie, du côté de Chazallette ou de
Romorantin). Il se souvenait, l’œil pétillant, de sa première rencontre
avec le poète Georges-Louis Godeau. Celle-ci avait failli tourner court à
cause d’une bagarre qui éclata, avant même qu’ils se soient serrés la
main, entre leurs chiens, menaçant de déchirer, à coups de crocs, une
complicité qu’ils avaient solidement nouée par correspondance.
Un soir à Rennes, il m’annonça qu’il ne fallait surtout pas que je
m’étonne si je voyais, le lendemain matin en venant le chercher, le
drapeau noir flotter fièrement sur le toit de l’hôtel où il devait
passer la nuit. Pince-sans-rire, il humait ce soir-là un verre de
blanc. Il s’humectait les lèvres, faisait rouler le vin dans sa bouche,
claquait la langue, s’arrangeait pour maintenir le Pouilly-Fuissé en
équilibre en haut de sa gorge avant de l’avaler avec lenteur en
soupirant longuement... Il s’empara ensuite d’un cigarillo, gratta une
allumette, l’alluma comme à la bougie. Visage tendu par le rituel, il se
détendit lentement. Devint tout à coup paisible, calme, avenant. Et
reprit la discussion là où on l’avait laissée. Très exactement chez
Brunetti. À la table du fond. Avec les forbans et les croque-morts. Où
l’on s’attendait à voir débarquer d’un moment à l’autre, L’Ange au
gilet rouge.






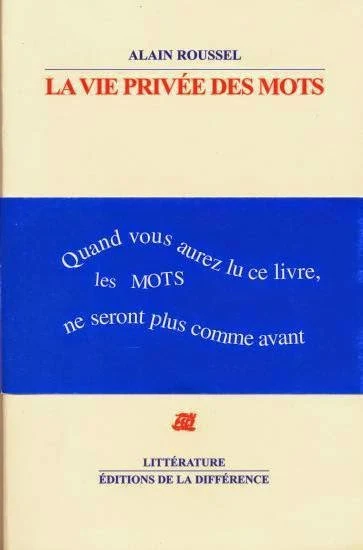








.png)



